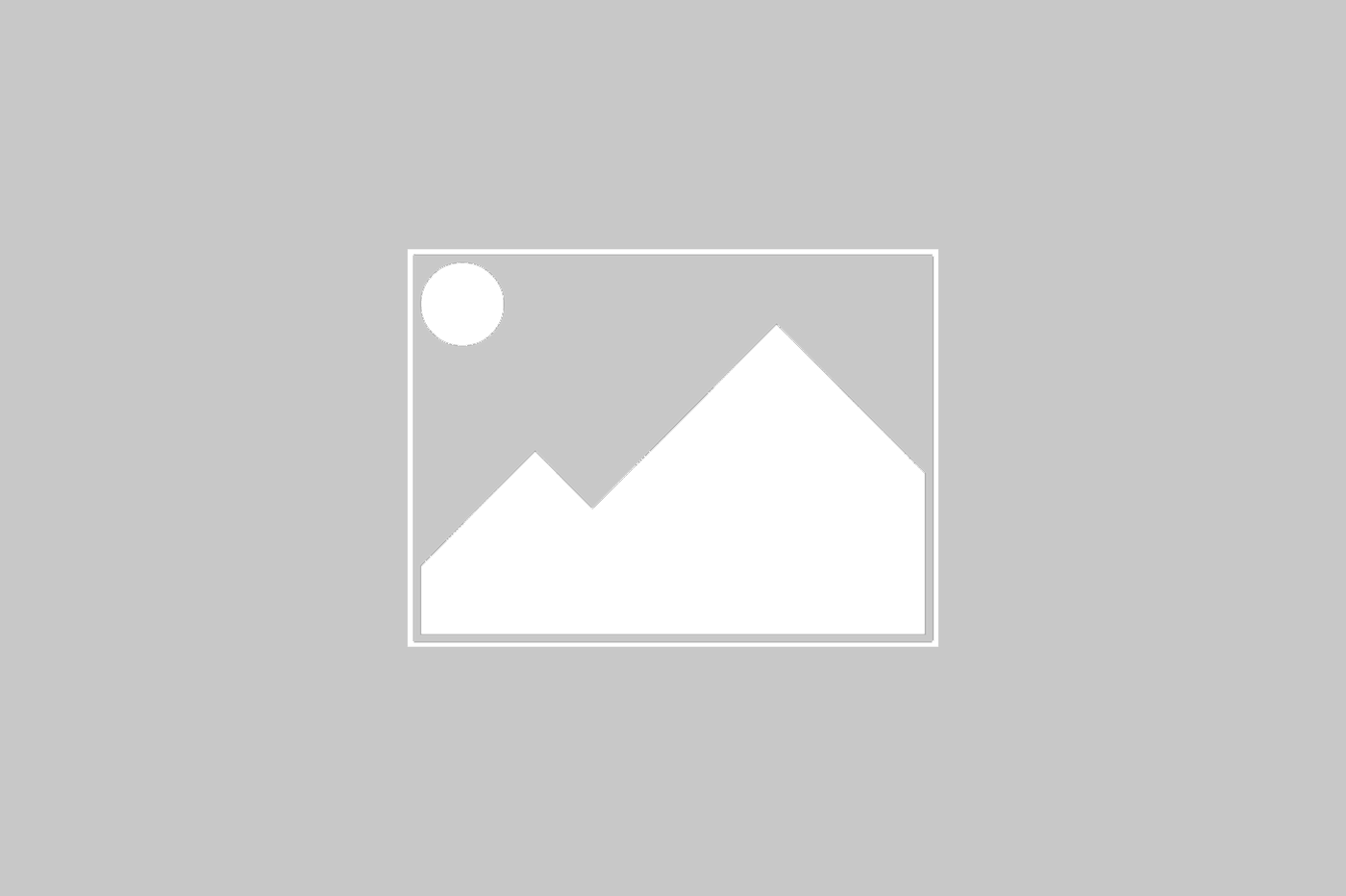San Francisco. Son Golden Gate. Ses rues pentues. Et, surtout, sa Silicon Valley, traversée du nord au sud par la “One O One”, une autoroute (presque) aussi mythique que la “66 “. Sans oublier sa récession, qui frappe durement d’orgueilleuses entreprises californiennes, comme Apple, Cisco Systems, Oracle ou Sun Microsystems… Tandis que des dizaines d’autres, moins connues en Europe, licencient du personnel à tour de bras ou mettent carrément la clé sous la porte. “C’est un peu la gueule de bois après une grosse fête”, admet François Laugier, avocat d’affaires établi à Redwood City. Le modèle américain tremble sur ses bases et, pourtant, il reste “la” référence pour les entreprises françaises des technologies, des médias ou des télécoms (TMT).Il faut donc y aller. “D’abord parce que ce marché représente à lui seul la moitié du marché mondial dans nos métiers, argumente Pierre Haren, PDG d’ILOG. Pour faire des affaires et vraiment compter dans notre secteur, on ne peut pas se priver d’une présence là-bas.” Patron de l’éditeur de logiciels SILICOMP, Jean-Michel Gliner ajoute qu’“une présence active aux États-Unis permet également de déceler les tendances de nos métiers à un horizon de 12-14 mois “. Selon Albert Hakim, directeur général d’ARCHOS, société de matériel électronique, la traversée de l’Atlantique se justifiait autrement : “Comme sous-traitants, nous n’étions pas connus du grand public. Au moment où nous avons voulu lancer notre propre marque, il fallait commencer par les États-Unis, parce que seul ce marché vous donne réellement votre chance.” Patrick Lhenry, PDG de PS’ SOFT, une autre entreprise de logiciel, y verrait même une question de survie : “Ne pas se développer outre-Atlantique impliquerait à terme, pour une entreprise française, le risque de perdre sa crédibilité et sa position sur son marché domestique.”Encore faut-il prendre pied sérieusement sur le continent américain, développer ses ventes, créer une filiale en temps et en heure puis, le cas échéant, envisager une cotation au Nasdaq, le marché d’élection des valeurs high-tech. Un enchaînement de rêve… qui n’est pas à la portée de la première entreprise française venue. “Au début, raconte Bernard Liautaud, PDG de l’éditeur de logiciels BUSINESS OBJECTS (BO), le fait d’être européen constituait plutôt un handicap aux États-Unis, en particulier dans l’industrie du logiciel. Pour contourner le problème, nous avons opté dès le départ un nom anglo-saxon.”Dans sa logique de devenir une société mondiale dès le départ, en misant sur une reconnaissance par le marché américain, BO, spécialisée dans la business intelligence (aide à la décision, etc.) a d’abord sollicité une cotation à Wall Street, en 1994, avant de franchir l’Atlantique vers Paris et son Premier Marché, quelques années plus tard. Mais BO apparaît un peu comme l’exception qui confirme la règle. Les membres du petit club des sociétés françaises cotées au Nasdaq effectuent généralement le chemin inverse (cotation en France d’abord, aux États-Unis ensuite), avec le ferme espoir d’y remplir deux objectifs : obtenir une plus grande visibilité et renforcer leur crédibilité auprès de leurs clients et des investisseurs. “L’arrivée au Nasdaq nous a essentiellement apporté la reconnaissance par le marché”, avoue Alain Tingaud, le numéro 1 d’INFOVISTA. “Si le fait d’être coté au Nasdaq rassure le client et l’investisseur, explique Michel Alard, PDG de Wavecom, c’est surtout parce que cette présence nous oblige à respecter des règles très strictes en matière d’information sur la société.”
La transparence à marche forcée
La transparence, s’il vous plaît, et trimestrielle en plus ! Léger en apparence, le changement est en réalité très profond. “Dès 1995-1996, raconte Pierre Haren, d’Ilog, nous nous étions habitués à produire des résultats trimestriels, et non plus annuels. Une révolution dans notre manière de travailler ! Avant, on cherchait à conclure les affaires en cours en décembre. Maintenant, la même bataille commerciale se passe chaque trimestre. On fait pression sur le client.” Jean-Michel Gliner s’en réjouit, et lâche un “il faut que les commerciaux aient faim comme des loups !” se passant de tout commentaire. Cette “trimestrialisation” de l’économie “est symptomatique de la réactivité américaine et d’une vision à court terme, juge Pierre Haren. Ce n’est pas nécessairement très intelligent, mais c’est comme ça “. Et, sur les marchés anglo-saxons, pas question de transiger avec certaines règles ?” parfois non écrites ?” de la communication. Serge Tchuruk, le patron d’ALCATEL, se souvient certainement encore de ce mois de septembre 1998, un véritable septembre noir : après avoir annoncé des résultats décevants par rapport aux attentes des analystes financiers et des fonds de pension, essentiellement américains, l’équipementier télécoms français a immédiatement vu son action plonger de 38 %. En quelques semaines, elle avait perdu deux tiers de sa valeur.
Les Français en quête de crédibilité
Sans doute faut-il s’habituer à l’idée que, dans le monde des TMT, la domination américaine se décline sur tous les modes, frôlant parfois la dictature. Il y a quelques années, des analystes financiers anglo-saxons avaient ainsi refusé de couvrir la présentation des comptes de TF1 parce que ceux-ci n’étaient pas présentés selon les normes américaines! Plier ou casser : voilà les termes de l’alternative. Cela dit, les acteurs français des technologies, des médias et des télécoms semblent bien intégrer cette donnée. Pour préparer son introduction au Nasdaq en 1994, Business Objects avait engagé un directeur financier américain et s’était largement appuyé sur des compatriotes ?” expérimentés ?” membres de son conseil d’administration ; quand THOMSON MULTIMEDIA (TMM), le premier groupe hexagonal d’électronique grand public, envisage la promotion de cadres français au sein de son comité opérationnel, “il faut que ces [derniers] soient crédibles au yeux des Américains qui siègent dans [cette instance] “, indique Olivier Barberot, directeur des ressources humaines de TMM. Comme le résume Bernard Liautaud, de BO, ” à partir du moment où une entreprise française se comporte comme une entreprise américaine, être français n’est pas un problème “. Certes.Et puis, il y a aussi cet exercice que redoutent tant de patrons français : le “road show” aux États-Unis. “Le but du jeu, pour l’entreprise candidate à l’introduction au Nasdaq, consiste à caser un maximum de rendez-vous à un maximum d’endroits en un minimum de temps. On débarque de jets privés pour s’engouffrer dans de luxueuses limousines, le tout pour convaincre, en anglais, un maximum d’investisseurs d’apporter un maximum de fonds, résume Michel Alard. À chaque fois, vous disposez de dix minutes. La tension est permanente.” Stress et paillettes, en quelque sorte… L’argent vole de tout côté, immatériel, irréel. Parce que cet argent n’existe pas encore réellement au moment du road show : “Les coûts de l’opération sont déduits des sommes que vous allez lever, note encore Pierre Haren. Et, pour les gens qui gravitent autour de vous pendant cette période, l’argent ne compte pas. Le film manque un peu d’éthique…”
Une acclimatation sous pression
Le PDG d’Ilog raconte volontiers, et avec verve, l’histoire de ce banquier d’affaires qui ne s’habillait qu’avec des chemises neuves, abandonnant chaque soir celle qu’il avait portée pendant la journée, parce qu’il n’avait ni le temps, ni même l’envie, de la faire laver et repasser par le blanchisseur de l’hôtel ! Il y a de quoi perdre pied… Pour résister à la pression physique et psychologique du road show, Michel Alard portait régulièrement ses regards vers une photo du manoir qu’il envisageait alors d’acquérir en France. “Afin de me rappeler pourquoi je faisais tout cela”, s’excuse-t-il. Afin de se rappeler, aussi, pourquoi il s’est soumis à de multiples “media trainings” avant son road show. Question de langue, bien sûr : “Les patrons français craignent souvent de ne pas être capables d’apporter toutes les nuances nécessaires à leurs propos en anglais”, note Jane Woodward, directrice de l’agence de relations publiques Akka. Mais pas seulement. “Nos clients français attendent également de nous qu’on les prépare aux contacts avec les analystes financiers et les journalistes anglo-saxons, pour les aider à réagir adéquatement aux questions plus directes, moins respectueuses et moins pudiques que celles posées en France.”A peine une quinzaine d’entreprises TMT hexagonales bénéficient d’une cotation à New York, que ce soit au New York Stock Exchange (Nyse) ou sur le Nasdaq. Derrière un tel projet, il y a nécessairement énormément d’investissements en temps, en énergie et en argent. Ce n’est pas à la portée de toute société. Ainsi Albert Hakim, d’Archos, explique-t-il que “la vocation [de sa société] est d’aller en Bourse, ne fût-ce que pour nourrir une éventuelle croissance externe. Nous le ferons en 2002 si les conditions de marché le permettent. Mais pas au Nasdaq, d’abord parce que nous ne fabriquons rien aux États-Unis et puis, surtout, parce que cela coûte trop cher pour une société de notre taille “. Un avis partagé par Patrick Lhenry, de PS’ Soft, qui évalue le coût d’une telle opération à 1 million de dollars (1,12 millions d’euros), “sans oublier la lourdeur des démarches à intégrer avant et surtout après, le reporting financier, la communication financière, etc. “. Alain Tingaud, le PDG d’Infovista, confie pour sa part: “Je considère que l’arrivée au Nasdaq nous a coûté 3 ou 4 millions de dollars, sans compter la rémunération de nos banquiers.” En outre, “pour réussir une telle opération, poursuit le patron de la société de logiciels, il faut être bien dans sa tête, dans sa famille, son équipe professionnelle. Je suis un ancien joueur de rugby, j’accorde une énorme importance à la notion d’équipe. Eh bien, l’équipe d’Infovista est sortie encore plus soudée de l’entrée au Nasdaq.”
L’ambition chevillée au corps
Les patrons français égrènent volontiers d’excellents arguments, plus rationnels les uns que les autres, pour expliquer la genèse de leur expansion outre-Atlantique. Mais la raison permet-elle de tout comprendre ? Au détour d’un entretien, Michel Alard reconnaît en effet qu’avec une cotation au Nasdaq, “on a un peu l’impression de jouer dans la cour des grands “. Un peu comme si les chevilles gonflaient en survolant l’Atlantique… Ce syndrome affecterait-il également un pur produit des grandes écoles françaises comme Jean-Marie Messier ? Dans une interview accordée à Libération, le très médiatique patron de VIVENDI UNIVERSAL semblait en tout cas très fier de sa percée à New York : “Richard [Grasso, le patron du Nyse, ndlr] m’a confirmé que j’allais être coopté au conseil d’administration du Nyse en mars.” Commentaire du quotidien parisien : “J2M parade comme un coq. Il est le premier Français invité au tour de table de la Bourse américaine. Et ça, il a-do-re ; être le premier.” Au point d’être devenu un brin mégalo ? “Sûrement pas Messier ! tranche Valérie Verant, directeur associé de la société de conseil en management Absylone. S’il était mégalo, il n’aurait pas réussi un parcours aussi brillant. En revanche, que Jean-Marie Messier concentre ses efforts de communication vers les États-Unis n’a rien de surprenant. Il doit construire des relais locaux pour assurer vraiment son pouvoir sur Vivendi Universal, même si cette stratégie le dessert en France, où un certain nombre de ses salariés ont l’impression qu’il n’y a plus de patron au pays.”
Tous des Américains ?
Pouvoir… Le mot est lâché. Impossible d’analyser la politique d’expansion à l’étranger des entreprises françaises sans envisager cette dimension. Après tout, si la fusion entre l’Américain Lucent Technologies et Alcatel a échoué, c’est essentiellement parce que la répartition du pouvoir entre Français et Américains ne convenait pas à ces derniers, dans une industrie emblématique aux États-Unis. Le souci du pouvoir ne concerne pas seulement les grosses boîtes. Quand Jean-Michel Gliner envisage de solliciter une cotation de Silicomp au Nasdaq, il précise aussitôt qu’“il y aura un QG à New York, et que ce QG sera dirigé par le président, c’est-à-dire moi, ou par le directeur général “. Objectif sous-jacent du dirigeant de la société de logiciels : garder la maîtrise d’un développement fondamental de l’entreprise et asseoir sa visibilité. “Aujourd’hui, je suis basé en Californie, explique pour sa part Bernard Liautaud (marié à une Californienne). Je m’y suis installé dès 1992, pour forcer le marketing de Business Objects à regarder en permanence vers les États-Unis. Je viens en Europe une semaine par mois, pour gérer les problèmes éventuels et pour rassurer.” À l’aune de ces expériences, le comportement de Jean-Marie Messier ne serait donc pas illogique. Mais à force de communiquer tous azimuts, le patron de Vivendi Universal a sans doute fini par irriter. Même quand il cherche à bien faire : dans un message du 13 septembre 2001 adressé à l’ensemble des employés du groupe, il tenait à exprimer l’horreur qu’il avait ressentie le 11. Et d’ajouter : “Mes pensées et mes prières continuent à vous accompagner pendant cette période de grande tristesse”, rappelant au passage ?” et toujours en anglais ?” qu’“en dépit de mon pays d’origine, je me suis senti Américain “. Le petit drapeau Stars and Stripes, toujours accroché à sa boutonnière à la mi-novembre à New York, confirme le message. Difficile à comprendre pour un Européen, sans doute. Il y a là comme un choc des cultures.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.